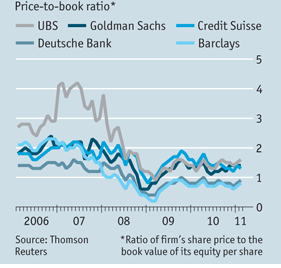L'excellent blog Sober Look a publié ces deux graphiques qui parlent d'eux mêmes et qui sont relatifs au marché interbancaire américain. Le premier graphique montre l'évolution du marché inter-bancaire américain sur longue période qui chute après Lehmann. Le deuxième rapporte la proportion du financement par le marché bancaire au total de bilan des banques commerciales américaine qui, en parallèle, baisse très sensiblement.
Ceci met en exergue que le phénomène n'est pas propre à l'Europe.
Il s'explique sans doute par une défiance entre banques qui les conduit à préférer déposer leur excédents à la Fed qui, comme la BCE, se substitue largement au marché inter-bancaire. Ce qui a un coût non négligeable pour les banques car elles empruntent auprès de la banque centrale à des conditions plus onéreuses qu'elles ne lui prêtent.
Mais comme le souligne Sober Look, une autre explication, l'autre face de la même pièce, est que les banques veulent réduire, pour ce qui est de leur financement, leur dépendance à un marché inter-bancaire extrêmement volatile en cas de tensions.
Evidemment la décision que vient de prendre la BCE de ne plus rémunérer du tout les dépots change quelque peu la donne et va amener les banques à revoir leur politique de gestion de trésorerie.
Voir le post de Sober Look: